La cession forcée des contrats en cours en plan de cession est un enjeu majeur pour tout repreneur ou pour tous les cocontractants de l’entreprise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Est-ce que le contrat va être cédé ? À quelles conditions ?
Vient de paraître sur Amazon : Le Guide du Repreneur par Luc Arminjon
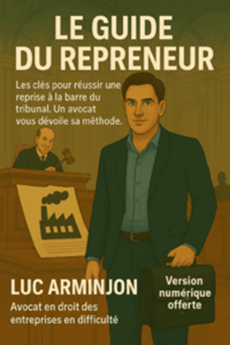
Le tribunal désigne précisément dans le jugement arrêtant le plan de cession
- les contrats repris par le cessionnaire,
- et donc qu’il devra exécuter.
MAIS, le tribunal ne peut pas imposer au repreneur la reprise de contrats qu’il n’aurait pas visés dans son offre.
Aussi, il est essentiel que le repreneur précise clairement les contrats qu’il entend reprendre à l’exclusion de tous les autres (bail, licences de logiciel, contrats fournisseurs etc.) Il est pour cela utile de bien préparer son offre en amont.
Le repreneur a tout intérêt à avoir des échanges avec l’entreprise en difficulté, l’administrateur et de bien examiner la data room numérique.
Il est aussi vivement recommandé au repreneur, même si les contrats lui sont cédés, de prendre contact avec les cocontractants stratégiques de l’entreprise en difficulté pour anticiper la suite de la relation commerciale.
Le repreneur liste dans son offre les contrats qu’il souhaite reprendre (bail, contrats de maintenance, etc.), mais le tribunal a le dernier mot. Le cocontractant est convoqué à l’audience pour faire valoir ses observations.fr
Quels contrats peuvent être cédés de force ?
L’article L. 642-7 du code de commerce liste trois grandes catégories de contrats transmissibles :
a. Les contrats de fourniture de biens ou services
Contrats fournisseurs, contrats de prestations de services, contrats de livraison de biens matériels nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, téléphonie, logiciels, énergie, maintenance informatique, etc. peuvent être transmis s’ils sont utiles au maintien de l’activité.
En résumé tous les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise cédée peuvent être transférés au repreneur qui en fait la demande.
b. Les contrats de crédit-bail
Il s’agit de contrats où l’entreprise loue un bien avec option d’achat. Ils peuvent être transmis au repreneur, à condition que celui-ci s’engage à respecter les échéances restant à courir. Pour lever l’option d’achat, il devra payer le solde dû ou négocier un accord (cf. ci-dessous la partie développée sur le crédit-bail).
c. Les contrats de location
Cela comprend notamment :
- les baux commerciaux,
- les baux professionnels,
- les locations mobilières (véhicules, équipements).
Tous les baux peuvent être repris si le tribunal les juge nécessaires à la poursuite de l’activité.
Quelles conditions pour qu’un contrat soit cédé au repreneur ?
- Le contrat doit être en cours
C’est-à-dire non résilié et toujours actif au moment de la cession. Même un contrat conclu pendant la période d’observation peut être repris s’il est en cours.
- Le contrat doit être nécessaire à la poursuite de l’activité
Le tribunal apprécie ce caractère « nécessaire ». Par exemple :
- le contrat d’entretien des équipements indispensables,
- un contrat avec un fournisseur unique,
- un contrat avec un client stratégique récurrent.
Attention : le simple souhait du repreneur ne suffit pas. Le tribunal vérifie l’utilité du contrat dans la logique économique du plan.
L’intuitu personae empêche-t-il la cession du contrat ?
Le caractère intuitu personae d’un contrat (conclu en considération de la personne du cocontractant, de ses dirigeants ou de ses actionnaires par exemple) n’empêche pas la cession si le contrat reste vital pour la poursuite de l’activité. C’est une analyse au cas par cas.
Par exemple, un contrat de franchise ou de concession peut être cédé.
Le cocontractant peut toujours faire valoir des arguments à l’audience, mais le tribunal tranche souverainement. Le cocontractant ne peut pas s’opposer à la cession de son contrat au repreneur.
Quel est le sort du contrat cédé ?
Le jugement qui arrête le plan de cession est opposable à tous (article L. 642-5 du code de commerce). Le tribunal désigne les contrats cédés au repreneur, ce qui remplace le consentement du cocontractant dont le contrat est cédé. Celui-ci ne peut s’opposer à la cession.
Une fois le contrat transmis, il doit être exécuté dans les mêmes conditions qu’auparavant par toutes les parties. Aucune modification ne peut être imposée unilatéralement par le repreneur ou le cocontractant.
Le contrat repris est ainsi poursuivi aux conditions antérieures :
- prix
- durée
- prestations dues
- clauses de renouvellement.
En pratique, pour les contrats stratégiques, il arrive que le repreneur et le cocontractant renégocient le contrat cédé. Cette renégociation peut aussi être dans l’intérêt du repreneur.
Le cocontractant garde toujours son droit de résilier un contrat à durée indéterminée moyennant un préavis ou de ne pas renouveler le contrat à son échéance.
La transmission du contrat de crédit-bail
Lorsqu’un repreneur demande, dans son offre, la transmission d’un contrat de crédit-bail, il est important de comprendre les implications financières et juridiques de cette demande.
En effet, le crédit-bail est un contrat particulier, situé entre la location et la vente à crédit, qui permet, à terme, au locataire (le crédit-preneur) de devenir propriétaire du bien en levant une option d’achat à l’issue du contrat de crédit-bail moyennant le paiement d’un prix résiduel.
Le contrat de crédit-bail peut être transféré par le tribunal au repreneur dans un plan de cession, même sans l’accord du crédit-bailleur (article L. 642-7 du code de commerce). Cela signifie que le crédit-bailleur ne peut s’opposer au transfert du contrat dès lors qu’il est inclus dans le jugement qui arrête le plan de cession.
En revanche, le droit de lever l’option d’achat — c’est-à-dire, de devenir propriétaire du bien en fin de contrat — n’est pas automatique pour le repreneur. Il est subordonné au paiement intégral de toutes les sommes dues au crédit-bailleur, notamment celles qui sont dues par l’entreprise cédée (le crédit-preneur initial), dans la limite de la valeur du bien au jour de la cession (article L. 642-7 du code de commerce).
Concrètement, cela signifie que pour pouvoir lever l’option d’achat, le repreneur devra :
– régler toutes les échéances non échues postérieures à la cession ;
– régler toutes les redevances échues (loyers impayés) avant la cession (généralement les échéances impayées par le débiteur au jour du jugement d’ouverture) ;
– régler les accessoires : pénalités, intérêts moratoires, etc. ;
– régler le prix résiduel de l’option d’achat prévu dans le contrat ;
– MAIS uniquement dans la limite de la valeur du bien, estimée à la date de la cession.
Exemple : si le bien vaut 40 000 € au jour de la cession, et que l’arriéré est de 55 000 €, le repreneur pourra lever l’option en payant la somme 40 000 € maximum.
Ce mécanisme vise à protéger les intérêts du crédit-bailleur en évitant que le repreneur devienne propriétaire du bien à un prix dérisoire.
La valeur du bien sert de plafond au montant que devra payer le repreneur pour lever l’option. En principe, cette valeur est fixée d’un commun accord entre le repreneur et le crédit-bailleur.
En cas de désaccord entre le crédit-bailleur et le repreneur, c’est le tribunal qui fixe la valeur du bien (article R. 642-8 du Code de commerce). Il peut recourir à une expertise.
Mais en pratique, les juridictions ne fixent pas toujours cette valeur.
Il est donc fortement recommandé au repreneur de négocier cette évaluation l’avance avance pour éviter les mauvaises surprises au moment de lever l’option.
Transmission des contrats de prêt et des conventions de crédit ?
Transmission des contrats de prêt
Les contrats de prêt ne figurent pas expressément dans la liste des contrats susceptibles d’être transférés au repreneur selon l’article L. 642-7 du code de commerce. Leur transmissibilité fait donc l’objet d’un traitement juridique spécifique.
Principe : les contrats de prêt sont en principe incessibles
La Cour de cassation a considéré que le contrat de prêt n’est pas transmissible lorsqu’il a été intégralement exécuté avant l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire lorsque les fonds ont été versés au débiteur avant le jugement d’ouverture. Le contrat est alors éteint dans sa substance, seule subsiste la dette de remboursement, soumise aux règles d’apurement du passif et à déclaration de la créance au passif par le prêteur (souvent une banque).
Le repreneur ne peut donc pas reprendre ce prêt et il ne peut pas être mis à sa charge.
Exception possible : prêt non encore décaissé
Dans de rares cas, si les fonds n’ont pas encore été remis à l’emprunteur (au débiteur en procédure collective) au jour du jugement d’ouverture, le prêt peut être considéré comme un contrat en cours, et donc potentiellement transférable. Mais cela reste une hypothèse très marginale.
Transmission des autres conventions de crédit
Les conventions de crédit autres que le prêt (appelées parfois « conventions de services financiers ») peuvent, sous conditions, être transmises dans un plan de cession.
Conditions de transmissibilité
Pour qu’une convention de crédit soit transmise :
– elle doit être en cours d’exécution au moment de la cession ;
– elle doit relever de la catégorie des contrats de fourniture de services, au sens de l’article L. 642-7 du code de commerce.
C’est notamment le cas :
– d’une convention-cadre de crédit assortie d’une autorisation d’escompte ;
– d’un découvert bancaire en cours d’utilisation ;
– d’un compte courant créditeur autorisé contractuellement.
Limites : l’intuitu personae financier
Certains établissements peuvent refuser la transmission si le contrat est fondé sur la confiance dans la personne du débiteur. En effet, le changement de cocontractant (débiteur en procédure collective remplacé par le repreneur) peut affecter le risque de crédit.
Caution et autres garanties
Les garanties personnelles (caution bancaire, garantie à première demande) ne sont pas transmissibles, car elles émanent d’un tiers et non du débiteur. Le repreneur ne peut donc pas bénéficier d’une garantie accordée à l’entreprise cédée.
Reprise du bail commercial et des baux de locaux professionnels
Le sort du bail commercial ou professionnel dans un plan de cession
1. Principe général
Dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise en difficulté, le bail commercial ou bail de local professionnel peut être transféré au repreneur. Deux fondements juridiques distincts permettent cette transmission :
- Par l’effet de la cession du fonds de commerce, selon l’article L.145-16 du Code de commerce, qui interdit au bailleur de s’opposer à la cession du bail au profit de l’acquéreur du fonds ;
- Ou par l’effet d’une cession forcée décidée par le tribunal, en application de l’article L.642-7 du code de commerce, lorsqu’il estime que le bail est nécessaire à la poursuite de l’activité.
Ces deux mécanismes présentent des conséquences juridiques et pratiques différentes qu’un repreneur doit bien maîtriser.
2. Spécificités de la cession forcée du bail (article L.642-7 du code de commerce)
Le recours à l’article L.642-7 pour faire transférer un bail présente plusieurs intérêts concrets pour le repreneur :
- Il neutralise toutes les clauses du bail qui pourraient restreindre la cession (exemple : exigence de l’accord du bailleur, clause de solidarité entre cédant et cessionnaire).
- Il assure la sécurité juridique du transfert : le bail est réputé transmis et opposable au bailleur, sans que ce dernier puisse invoquer un défaut de formalisme.
- Il protège le repreneur contre les tentatives du bailleur de remettre en cause la validité ou l’opposabilité de la cession.
Le tribunal, dans le jugement arrêtant le plan de cession, énumère les contrats transmis, dont le bail commercial s’il est jugé nécessaire à l’exploitation autonome de l’activité.
3. Conditions de la cession du bail dans un plan
La cession du bail commercial au profit du repreneur suppose que :
- Le tribunal ait expressément inclus le bail parmi les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité ;
- Le bailleur ait été entendu par le tribunal lors de l’audience, ce qui lui confère un droit d’appel du jugement (article L.661-6 III du Code de commerce) ;
- La cession soit nécessaire pour garantir la pérennité de l’activité transférée.
En complément, le tribunal peut autoriser le repreneur à étendre les activités exercées dans les locaux, notamment à des activités connexes ou complémentaires, même si cela n’était pas prévu au contrat de bail initial. Il peut ainsi autoriser une déspécialisation partielle du bail sans l’accord du bailleur, même si ce dernier est dûment entendu lors de l’audience qui arrête le plan de cession.
4. Effets de la cession judiciaire du bail
Le jugement de cession :
- Écarte toutes les clauses contractuelles limitatives, notamment celles imposant des formalités de cession spécifiques ou une autorisation expresse du bailleur.
- Rend inapplicables les clauses de solidarité entre le cédant (le débiteur) et le cessionnaire (le repreneur). Ces clauses sont réputées non écrites depuis la loi PACTE.
- Exclut l’exercice du droit de préemption du bailleur. Contrairement aux cessions classiques, le bailleur ne peut pas se substituer au repreneur désigné par le tribunal.
- Le repreneur est tenu de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur ou de le rembourser à l’administrateur ou au liquidateur. Si le bail exige une caution bancaire ou une garantie à première demande, le repreneur sera tenu de la fournir. Il est tenu de respecter les clauses du bail.
Ainsi, le repreneur bénéficie d’un transfert clair et sécurisé du contrat de bail, sans risque de contestation ultérieure par le bailleur sur le fondement du contrat.
5. Recommandations pour le repreneur
Avant de déposer une offre de reprise :
- Identifiez-le ou les baux nécessaires à l’activité que vous souhaitez reprendre.
- Vérifiez leur contenu (durée restante, loyer, révision, charges, clauses restrictives).
- Demandez expressément dans votre offre que le bail soit transféré au titre de l’article L.642-7. Cela est plus avantageux que son transfert dans le cadre de la reprise du fonds de commerce où par exemple la clause d’agrément au bénéfice du bailleur pourrait s’appliquer.
- En cas de besoin, anticipez une demande d’extension d’activité autorisée.
En résumé, le bail commercial est un actif stratégique dans une opération de reprise. Le repreneur a tout intérêt à s’assurer de son transfert dans le cadre du plan de cession, en tirant parti des garanties offertes par l’article L.642-7 du code de commerce. Cela lui permet de bénéficier d’un droit au renouvellement, d’une stabilité contractuelle, et d’une protection renforcée contre les contestations du bailleur.
Que se passe-t-il si le contrat est soumis à agrément administratif ?
Certaines activités (radio, télévision, services publics, etc.) nécessitent une autorisation préalable (ARCOM, DGCCRF, etc.).
Même si le contrat est transmis judiciairement, le repreneur devra obtenir l’agrément ou l’autorisation pour pouvoir en bénéficier pleinement.
Le candidat repreneur a l’obligation de consulter l’autorité administrative avant l’audience où le tribunal statue sur les offres. Le repreneur doit faire connaître les diligences effectuées au tribunal (article L. 642-4-1 du code de commerce).
De même dans le cas de la reprise d’un restaurant ou d’un bar avec une Licence IV, le repreneur devra, le cas échéant, obtenir les qualifications ou agréments requis s’il ne les possède pas encore.
LEXIQUE
- « Repreneur » ou « Cessionnaire » ou « Candidat repreneur » : ces termes seront utilisés indifféremment pour désigner la personne physique ou morale (une société) qui fera une offre de reprise d’une entreprise en difficulté (actifs, contrats, salariés) et/ou dont l’offre aura été acceptée par le tribunal.
- « Entreprise en difficulté » ou « débiteur » ou « cédant » désignent indifféremment la personne morale ou la personne physique qui fait l’objet d’une procédure collective. Le repreneur fait une offre de reprise de tout ou partie de l’activité d’une entreprise en difficulté.
Ces termes peuvent le cas échéant désigner l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de prévention des difficultés des entreprises : Mandat ad hoc ou Conciliation.
- « Procédure collective » désigne soit une procédure de sauvegarde, soit une procédure de redressement judiciaire, soit une procédure de liquidation judiciaire. La procédure collective d’une entreprise est ouverte par un jugement du tribunal appelé jugement d’ouverture. Quand cela sera nécessaire, la procédure collective en question sera précisée.
- « Offre de reprise » désigne l’offre de rachat faite par le repreneur « à la barre du tribunal » de toute ou partie d’une activité d’une entreprise en procédure collective susceptible d’une exploitation autonome. Cette offre comprendra notamment la reprise d’actifs, de contrats en cours et de salariés d’une entreprise en difficulté.
- « Plan de cession totale ou partielle » ou « plan de cession » ou « cession totale ou partielle » ou « cession » désignent soit le projet de cession de l’entreprise en procédure collective, soit la décision du tribunal qui détermine dans son jugement la ou les offre(s) de reprises retenue(s) au bénéfice d’un ou plusieurs candidat(s) repreneur(s). La précision sera donnée quand cela s’avèrera nécessaire.
- « Dépôt de bilan » est devenue une expression du langage courant qui désigne l’acte par lequel le chef d’entreprise demande au tribunal d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de son entreprise. Dans le cas d’une demande de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le chef d’entreprise procèdera à une déclaration de cessation des paiements.
Vient de paraître sur Amazon : Le Guide du Repreneur par Luc Arminjon
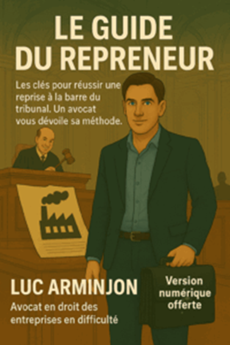
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Pour toute question sur les offres de reprises et les procédures collectives, contactez-moi depuis mon formulaire de contact ou prenez rendez-vous en ligne.
Maître Luc Arminjon – Avocat en droit des entreprises en difficulté
