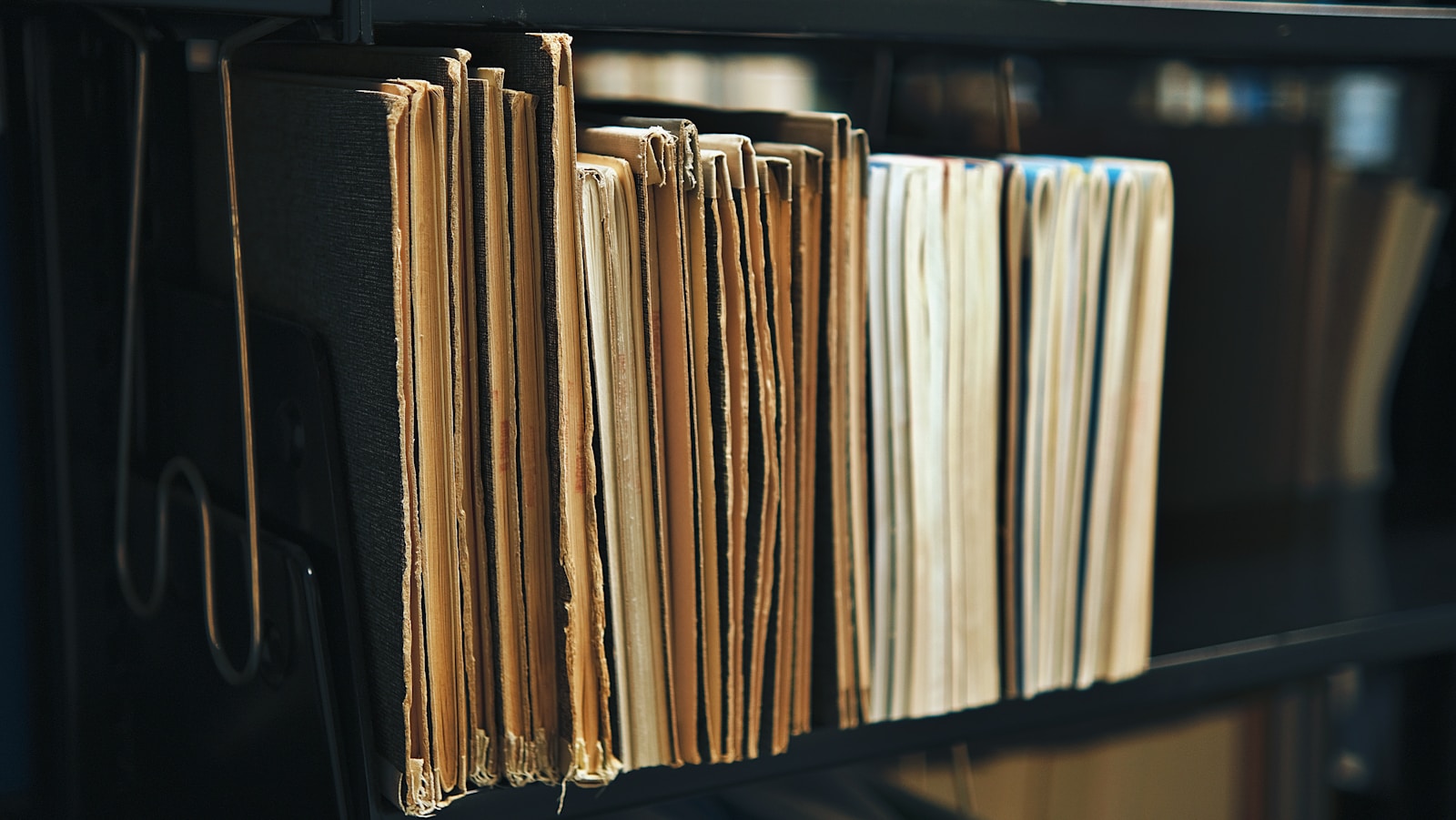🔹 Définition – continuation des contrats en cours
La continuation des contrats en cours permet, en cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire), à l’administrateur judiciaire – ou au débiteur selon la procédure – d’imposer la poursuite des contrats nécessaires à l’activité de l’entreprise, nonobstant toute clause contraire, sous réserve du paiement des prestations postérieures au jugement d’ouverture.
Qu’est-ce que la continuation des contrats en cours ?
La continuation des contrats en cours constitue un mécanisme central du droit des entreprises en difficulté. Elle vise à assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise placée en procédure collective, en empêchant les cocontractants de résilier ou de suspendre unilatéralement les contrats en raison de l’ouverture de la procédure.
Ce mécanisme permet ainsi de préserver les relations contractuelles indispensables à l’exploitation de l’entreprise (fourniture, bail, prestations de services, contrats informatiques, etc.), sous le contrôle de l’administrateur judiciaire et dans les conditions prévues par le Code de commerce.
Dans une procédure collective, la continuation des contrats en cours est ainsi un enjeu majeur pour la survie de l’entreprise. La poursuite des contrats en cours s’applique en sauveagrde, redressement judiciaire et même en liquidation judiciaire.
Par Luc Arminjon, avocat en droit des entreprises en difficulté : sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, conciliation et mandat ad hoc, reprise d’entreprises en difficulté et défense des dirigeants.
Le droit des procédures collectives encadre donc de manière précise la poursuite des contrats dits « en cours », dans le but de concilier la protection du patrimoine du débiteur (l’entreprise en difficulté), l’intérêt de ses créanciers, et la sauvegarde de l’activité.
Le législateur a ainsi souhaité garantir que l’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas de désorganisation supplémentaire de l’entreprise par l’effet de ruptures contractuelles brutales.
Le régime spécial des contrats en cours répond également à une logique économique : permettre à l’entreprise de continuer à bénéficier des contrats utiles à la poursuite de son exploitation tout en sécurisant les partenaires contractuels.
Le contrat en cours se poursuit malgré l’ouverture de la procédure collective
Le principe est la continuation des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le contrat se poursuit même si l’entreprise en procédure collective ne vous a pas payé une prestation ou une livraison avant le jugement d’ouverture ou a commis des inexécutions contractuelles.
Inopposabilité des clauses résolutoires automatiques
L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure collective ne peut, par elle-même, entraîner la résiliation d’un contrat.
Toute clause prévoyant la résiliation automatique du contrat en cas d’ouverture d’une telle procédure est donc inopposable.
Ainsi, un fournisseur ne peut se prévaloir d’une clause de résolution de plein droit pour cesser ses livraisons au seul motif de la mise en redressement judiciaire de son client. Cette protection empêche que des cocontractants, souvent en position de force, ne fragilisent encore davantage la situation du débiteur en cours de procédure.
Maintien des obligations contractuelles
Lorsque l’administrateur, le liquidateur ou le débiteur en l’absence d’administrateur décide de poursuivre l’exécution d’un contrat en cours, il est tenu d’en respecter toutes les clauses et conditions du contrat.
Cela implique notamment que :
- Le contrat doit être exécuté jusqu’à son terme initialement convenu, même si, entre-temps, il n’a plus d’intérêt économique pour l’entreprise poursuivie.
- Une clause de compensation conventionnelle, dès lors qu’elle ne tombe pas dans la période suspecte, reste pleinement applicable.
- Le vendeur de marchandises peut refuser de livrer tant qu’il n’a pas reçu le paiement, en application de l’exception d’inexécution.
- Les clauses résolutoires inscrites dans le contrat conservent leurs effets, à l’exception de celles visant expressément l’ouverture d’une procédure collective. Il en va de même pour les clauses prévoyant des indemnités de résiliation, mais elles doivent faire l’objet d’une déclaration de créance au passif du débiteur.
- Les clauses attributives de compétence juridictionnelle ainsi que les clauses compromissoires ou d’arbitrage continuent également de produire leurs effets.
Par ailleurs, en cas de conversion de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le liquidateur reste tenu des engagements contractés par l’administrateur avant la conversion, notamment à l’égard du bailleur.
Enfin, les créances nées de la poursuite du contrat sont exigibles à leur échéance et, à défaut, bénéficient du privilège de paieemnt prévu par le droit des procédures collectives.
Toutefois, un défaut d’exécution du débiteur antérieur au jugement d’ouverture peut générer un préjudice qui doit faire l’objet d’une déclaration de créance au passif.
Cas où la résiliation demeure possible
Bien que les textes visent de manière générale les « engagements antérieurs » du débiteur, il convient de préciser qu’ils ne concernent que l’inexécution d’une obligation de paiement et non celle d’une obligation de faire.
En effet, ces dispositions (articles L. 622-7 et L. 622-21 du Code de commerce) s’inscrivent dans la logique des règles interdisant, d’une part, le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture (art. L. 622-7) et, d’autre part, les poursuites de la part des créanciers pour de telles créances (art. L. 622-21).
Ainsi, la procédure collective ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat engagée pour un manquement autre qu’un simple défaut de paiement d’une somme d’argent. Cela signifie que lorsque le débiteur a commis un manquement contractuel avant l’ouverture de la procédure collective autre que le paiement d’une somme d’argent, la résiliation peut produire ses effets malgré la procédure collective si le cocontractant poursuit ou engage une action en résiliation du contrat.
Ainsi, est valable la résiliation d’un contrat de concession fondée sur la mise en œuvre, avant l’ouverture de la procédure collective, d’une clause résolutoire pour inexécution d’une obligation contractuelle non pécuniaire (par exemple, un manquement à une clause d’exclusivité).
Qu’est-ce qu’un contrat en cours
Un contrat en cours est un contrat (L. 622-13 du Code de commerce) :
- toujours en vigueur à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
- et non entièrement exécuté. Il faut qu’il subsiste au moins des effets en faveur du débiteur ;
- peu importe que le contrat soit intuitu personae.
Ce régime s’applique à tout type de contrat. Il s’agit le plus souvent de contrats à exécution successive, c’est-à-dire dont l’exécution se poursuit dans le temps comme le bail.
Voici quelques exemples de contrats en cours :
- Les baux,
- les contrats de fourniture,
- les contrats de prestations de services,
- les contrats de sous-traitance (la jurisprudence précise que le maître d’ouvrage ne peut pas imposer la poursuite à un sous-traitant contre son gré, sauf à ce que ce dernier accepte expressément la continuation du contrat),
- les contrats informatiques,
- contrats de franchise ou encore les contrats de distribution exclusive ou sélective,
- contrats intuitu personae,
- conventions de crédit.
- Contrats à exécution instantanée qui n’ont pas encore produit tous leurs effets :
- Contrat de vente dont le transfert de propriété n’a pas eu lieu avant le jugement d’ouverture (par exemple une cession de parts sociales dont le transfert de propriété n’a pas encore eu lieu).
- MAIS un contrat de vente avec clause de réserve de propriété n’est pas un contrat en cours. Vous pourrez revendiquer le bien entre les mains du débiteur et obtenir sa restitution ou le paiement du prix du bien sur autorisation (exception à l’interdiction des paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture).
Un bail commercial est en cours tant que l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit n’est pas constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture du preneur.
Certains contrats, bien qu’en cours, peuvent faire l’objet de régimes dérogatoires ou spécifiques prévus par d’autres textes comme les contrats de travail. Il convient donc toujours de vérifier les dispositions particulières applicables au contrat concerné.
Les contrats arrivés à échéance, totalement exécutés, ou résiliés avant l’ouverture de la procédure ne sont pas considérés comme des contrats en cours.
Le défaut d’exécution du contrat antérieur au jugement d’ouverture est sans effet sur la poursuite du contrat s’il s’agit du non-paiement d’une somme d’argent
Par exemple, un prestataire informatique ayant livré un logiciel au débiteur avant l’ouverture de la procédure et n’ayant pas été réglé ne peut s’opposer à la poursuite du contrat en arguant du non-paiement de cette prestation antérieure. Il devra déclarer sa créance au passif.
Un fournisseur ne peut pas refuser la livraison d’une commande en cours d’exécution au seul motif que les livraisons antérieures n’ont pas été payées. Il devra déclarer sa créance au passif pour les livraisons impayées.
Qui décide de la poursuite du contrat ?
L’administrateur judiciaire, le liquidateur ou le débiteur selon les cas
En sauvegarde ou en redressement judiciaire, le droit d’exiger la poursuite d’un contrat appartient à l’administrateur judiciaire. Si aucun administrateur n’est désigné, le débiteur peut solliciter la poursuite, avec l’accord du mandataire judiciaire.
En liquidation judiciaire, ce pouvoir revient au liquidateur. Cette poursuite peut être exigée même si l’activité de l’entreprise n’est pas maintenue.
Formalisation de la poursuite du contrat par le débiteur
La poursuite du contrat en cours par le débiteur peut être expresse ou tacite (par exemple l’exécution spontanée du contrat en cours par l’administrateur). Elle n’exige pas de forme particulière, mais un écrit est recommandé pour des raisons probatoires. Par exemple, la simple exécution continue d’un contrat (livraisons, prestations, paiements) peut valoir manifestation tacite de volonté de poursuite.
Décision de non-poursuite du contrat par l’administrateur ou le liquidateur
L’administrateur ou le liquidateur peuvent renoncer expressément à la poursuite du contrat avant d’avoir reçu la mise en demeure du cocontractant. Le contrat est alors résilié dès la renonciation.
En l’absence de mise en demeure préalable du cocontractant, la décision de l’administrateur ou du liquidateur de renoncer à la poursuite d’un contrat, qu’il avait pourtant initialement décidé de maintenir, n’emporte pas, à elle seule, résiliation de plein droit.
Le cocontractant est alors en droit de solliciter judiciairement la résiliation du contrat auprès du juge-commissaire.
Conditions de la poursuite du contrat en cours
Fourniture de la prestation promise
La poursuite d’un contrat suppose que le débiteur exécute ses propres obligations. Il ne peut demander l’exécution d’un contrat sans fournir la contrepartie attendue. Par exemple, l’entrepriser en redressement judiciaire ne peut exiger la livraison d’un bien sans en payer le prix au comptant (sauf disposition contractuelle contraire en sauvegarde).
Il est important de noter, que sauf accord du cocontractant, le débiteur doit payer les prestations au comptant. Le paiement au comptant ne s’applique pas en procédure de sauvegarde où les délais contractuels de paiement restent en vigueur entre les parties.
Dans les contrats à exécution successive, comme un contrat de fourniture ou d’entretien, les obligations futures doivent être honorées au fur et à mesure de l’exécution du contrat, sauf dans la procédure de sauvegarde où les conditions contractuelles peuvent perdurer.
Conséquence du non-paiement par l’entreprise en procédure collective
Le non-paiement de la prestation par le débiteur empêche la poursuite du contrat, sauf accord du cocontractant.
Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit ( articles L 622-13, III-2° , L 631-14, al. 1 et L 641-11-1, III-al. 2° du code de commerce). MAIS, s’il s’agit du bail des locaux d’exploitation, le non-paiement d’une échéance n’entrainera pas la résiliation de plein droit du bail.
Le cocontractant peut saisir le juge-commissaire pour faire constater la résiliation et demander éventuellement des dommages et intérêts qu’il devra déclarer au passif.
Les droits du cocontractant de l’entreprise en procédure collective
Mise en demeure adressée à l’administrateur ou au liquidateur
Le cocontractant peut adresser une mise en demeure à l’administrateur ou au liquidateur pour l’enjoindre de se prononcer sur la poursuite du contrat.
En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, la résiliation intervient de plein droit. Il est recommandé d’envoyer la mise en demeure par LRAR. La mise en demeure doit être explicite.
Ce délai peut être prorogé par le juge-commissaire pour une durée de deux mois maximum.
Lorsque l’entreprise en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire n’est pas assistée par un administrateur judiciaire, c’est le débiteur lui-même qui se prononce sur la poursuite ou non du contrat en cours. Dans ce cas, le cocontractant doit lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en envoyant simultanément une copie au mandataire judiciaire (C. com., art. R. 627-1, al. 1).
Le mandataire doit alors faire connaître son avis sans délai au débiteur et au cocontractant. S’il ne répond pas dans les quinze jours suivant la réception de la mise en demeure par le débiteur, ce dernier peut saisir le juge-commissaire (art. R. 627-1, al. 2 et 3). Cette saisine suspend le délai d’un mois au terme duquel le contrat serait autrement résilié de plein droit, faute de réponse à la mise en demeure (art. R. 627-1, al. 4).
En cas de désaccord entre le débiteur et le mandataire judiciaire sur l’opportunité de poursuivre le contrat, le juge-commissaire peut être saisi par toute personne intéressée, y compris le cocontractant (C. com., art. L. 627-2).
Décision expresse de non-poursuite
Si l’administrateur ou le liquidateur indique expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat, celui-ci est résilié de plein droit la date de la réception par le cocontractant de ce refus.
En l’absence de mise en demeure, la simple abstention de l’administrateur ou du liquidateur n’entraîne pas la résiliation automatique du contrat. Le cocontractant devra saisir le juge-commissaire pour voir constater la résiliation judiciaire.
Procédure de résiliation d’un contrat en cours à la demande de l’administrateur ou du liquidateur
Résiliation du contrat à la demande de l’administrateur ou du liquidateur
En procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’administrateur peut saisir le juge-commissaire pour demander la résiliation d’un contrat en cours, à condition que cette résiliation soit nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et qu’elle ne cause pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (art. L. 622-13, IV et L. 631-14, al. 1).
Lorsque aucun administrateur n’a été désigné, c’est le débiteur qui exerce cette faculté. Il doit alors adresser ou déposer une requête au greffe, accompagnée de l’avis conforme du mandataire judiciaire (article R. 627-1, dernier al. et article R. 622-13, al. 3).
Le cocontractant est dans tous les cas convoqué à l’audience.
Le juge-commissaire peut refuser la résiliation du contrat en cours si cela affecte de manière excessive les droits du cocontractant (mais cela arrive très rarement) ou s’il considère que sa poursuite est nécessaire pour la poursuite de l’activité de l’entreprise.
En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire (ou l’administrateur, s’il a en été désigné un) peut également solliciter du juge-commissaire la résiliation d’un contrat, si cette mesure est nécessaire aux opérations de liquidation et n’affecte pas de manière excessive les droits du cocontractant.
Mais cette faculté n’est ouverte que si l’obligation du débiteur dans le cadre du contrat ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent (articles L. 641-11-1, IV et R. 641-21, al. 3 du code de commerce).
Lorsqu’un contrat en cours implique uniquement pour le débiteur le paiement d’une somme d’argent, ce contrat est résilié de plein droit dès le jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat (art. L. 641-11-1, III-3°). Cette résiliation automatique suppose impérativement que le liquidateur ait exprimé de manière claire et expresse sa volonté de ne pas poursuivre le contrat.
Créances postérieures d’un contrat en cours : paiement garanti
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les créances postérieures au jugement d’ouverture ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration (art. L 622-24, al. 6).
Les créances contractuelles bénéficient d’un paiement à l’échéance ou par privilège quand elles sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur (articles L 622-17, I et L 631-14, al. 1 du code de commerce).
Les créances privilégiés qui bébéficient de ce privilèges sont par exemple les créances de loyers impyés après le jugement d’ouverture, la créance d’un fournisseur qui a livré des biens au débiteur ou lui a fourni une prestation après le jugement d’ouverture.
Le concontractant bénéficie donc d’un privilège de paiement pour les créances nées du contrat poursuivi.
Intervention du juge-commissaire pour constater la résiliation
Le rôle du juge-commissaire dans la constatation ou la prononciation de la résiliation
Le juge-commissaire peut être saisi par toute personne intéressée afin de constater la résiliation de plein droit d’un contrat dans les cas prévus par les articles L. 622-13, III et L. 622-14 du Code de commerce (et L. 641-11-1, III et L. 641-12 en cas de liquidation judiciaire). Il statue également sur la date effective de la résiliation (C. com., art. R. 622-13, al. 2 ; R. 631-20 ; R. 641-21, al. 2).
Bien que son ordonnance ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers, elle leur est opposable pour ce qui concerne la constatation ou la prononciation de la résiliation du contrat (Cass. com., 11 sept. 2019, n° 18-11.401). Cela permet, par exemple, d’entraîner la caducité d’un contrat interdépendant dès lors que les conditions de l’article 1186 du Code civil sont réunies.
Quand faut-il saisir le juge-commissaire ?
L’intervention du juge-commissaire est obligatoire lorsque la résiliation pour défaut de paiement est demandée par l’administrateur ou le liquidateur, sur le fondement des articles L. 622-13, III-2° ou L. 641-11-1, III-2°, car le juge doit vérifier que ce défaut de paiement résulte bien d’une absence de fonds disponibles.
En revanche, lorsque la résiliation intervient de plein droit à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, il n’est pas nécessaire de la faire constater par le juge-commissaire (Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-12.693). Ce principe s’applique même dans le cadre de contrats administratifs (CE, 8 déc. 2017, n° 390906).
La saisine du juge-commissaire est donc requise uniquement en cas de contestation sur le fond. Par exemple, sur la nature du contrat, son caractère « en cours », la validité de la mise en demeure ou l’acquisition du délai.
En dehors de ces cas spécifiques, le juge des référés de droit commun peut intervenir. Il est compétent, par exemple, pour statuer sur la résiliation unilatérale d’un contrat poursuivi, lorsque le débat ne porte pas sur le régime des contrats en cours mais sur le droit commun (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-10.975).
Ce raisonnement s’applique aussi à la résiliation de plein droit résultant d’une décision expresse de non-poursuite par l’administrateur ou le liquidateur, y compris pour un bail. Si aucune contestation n’est soulevée, le juge des référés peut constater la résiliation à la date de réception de la lettre de renonciation (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-15.363).
Cas des demandes de résiliation judiciaire
Lorsque le cocontractant demande la résiliation judiciaire du contrat (par exemple, en cas d’inexécution postérieure au jugement d’ouverture), la compétence revient au juge de droit commun, et non au juge-commissaire (Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-13.542).
De même, une action visant à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail immobilier relève du juge des référés de droit commun, même si le contrat a été poursuivi pendant la procédure collective (Cass. com., 1er sept. 2013, n° 12-21.659).
Recours contre les décisions du juge-commissaire
Les ordonnances du juge-commissaire constatant ou prononçant la résiliation d’un contrat peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans un délai de dix jours à compter de leur notification ou communication (C. com., art. R. 621-21, R. 631-16, R. 641-11).
Le jugement rendu sur le recours est, quant à lui, susceptible d’appel (Cass. com., 7 févr. 2012, n° 10-26.164).
Régime spécifique du bail des locaux d’exploitation
Quels sont les baux concernés ?
Les prestations réalisées après l’ouverture de la procédure sont appelées créances postérieures.
Le Code de commerce prévoit un régime juridique spécifique pour la résiliation des baux portant sur les locaux nécessaires à l’activité de l’entreprise, lorsque la procédure collective est ouverte à l’encontre du locataire (articles L. 622-14, L. 631-14 et L. 641-12). Ce régime s’applique à tous types de baux (bail commercial, professionnel, rural), dès lors que les locaux sont exploités pour l’exercice de l’activité du débiteur.
En revanche, ce dispositif ne s’applique pas au crédit-bail immobilier ni au contrat de location-accession, qui relèvent du régime général des contrats en cours.
Résiliation à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur
Contrairement aux autres contrats en cours, le bail ne peut pas être résilié de plein droit par l’effet d’une simple mise en demeure restée sans réponse.
Le bail prend fin le jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur ou du liquidateur de ne pas continuer le bail (art. L. 622-14 et L. 641-12).
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur, c’est le débiteur qui décide de ne pas continuer le contrat avec l’avis conforme du mandataire judiciaire ; en cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé (art. L 627-2).
Enfin, l’administrateur peut renoncer à la poursuite du bail même si les loyers peuvent être payés (Cass. com., 24 janv. 2018, précité).
Conséquences financières de la résiliation du bail
Comme pour les autres contrats, la résiliation du bail peut entraîner la naissance d’une créance de dommages-intérêts au profit du bailleur. Cette créance est à déclarer au passif de la procédure. Le bailleur peut différer la restitution de certaines sommes (comme le dépôt de garantie) tant que cette créance n’a pas été fixée.
Résiliation à l’initiative du bailleur
- Pour un manquement antérieur au jugement d’ouverture
Le bailleur ne peut demander la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture. Il doit déclarer sa créance au passif (Cass. com., 3 nov. 1992, n° 1627). Toutefois, il peut demander la résiliation si l’inexécution concerne un manquement contractuel autre qu’un défaut de paiement
Lorsque la défaillance résulte d’un autre manquement (ex. : non-respect de l’usage des locaux), le bailleur peut engager une procédure de résiliation même après l’ouverture de la procédure collective, à condition que le fait générateur soit antérieur. En liquidation, il doit agir dans les trois mois de la publication du jugement (art. L. 641-12, 2°).
- Pour défaut de paiement postérieur au jugement d’ouverture
Le bailleur peut demander la résiliation à l’issue d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, s’il y a défaut de paiement des loyers postérieurs (art. L. 622-14, L. 631-14 et L. 641-12 ; Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-17.563). Ce délai court à compter du jugement (et non de sa publication).
Aussi, l’administrateur ou le liquidateur bénéficie d’un délai de paiement dans les mois qui suivent le jugement d’ouverture et peuvent régulariser le paiement jusqu’à l’expiration du délai de trois mois.
La requête du bailleur doit être déposée devant le juge-commissaire. Aucun commandement de payer n’est requis, sauf si le bailleur agit sur le fondement d’une clause résolutoire du bail, auquel cas le formalisme habituel s’applique (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-20.127).
Le juge-commissaire ne peut pas accorder de délais de paiement dans ce cadre (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.164). Toutefois, si une clause résolutoire est mise en œuvre, l’article L. 145-41 du Code de commerce permet au locataire (ou au mandataire) de solliciter des délais de paiement tant que la résiliation n’est pas devenue définitive (Cass. com., 6 déc. 2011, n° 10-25.689).
- Défaut d’exploitation des locaux après le jugement d’ouverture
En sauvegarde ou redressement judiciaire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation ne peut pas justifier la résiliation, même en présence d’une clause contraire (art. L. 622-14, al. 5 et L. 631-14).
L’incertitude demeure sur ce point en liquidation judiciaire.
Enfin, après adoption d’un plan (sauvegarde ou redressement), le défaut d’exploitation peut justifier une résiliation, notamment s’il compromet les intérêts du bailleur ou les droits à renouvellement du bail.
- Résiliation pour manquements postérieurs à l’ouverture
Le bailleur peut, à tout moment, engager une action en résiliation judiciaire (ou faire jouer une clause résolutoire) pour tout manquement postérieur au jugement d’ouverture, qu’il s’agisse ou non d’un défaut de paiement. Cette action n’est soumise ni au délai d’attente de trois mois, ni au délai de forclusion prévu pour les manquements antérieurs.
- Indemnités et dommages-intérêts
La résiliation ou la non-poursuite d’un contrat peut donner droit à une indemnité, conventionnelle ou judiciaire, pour le cocontractant. Cette indemnité a la nature d’une créance antérieure et doit être déclarée au passif de la procédure.
La créance d’indemnité doit être déclarée dans un délai d’un mois à compter de la résiliation du contrat ou de la notification de la non-poursuite. À défaut, le créancier est forclos et ne pourra pas participer à la répartition des dividendes.
Les contrats en cours dans un plan de cession
Lorsqu’un plan de cession est adopté, le tribunal peut autoriser la cession forcée des contrats en cours au repreneur. L’article L642-7 du Code de commerce permet en effet au cessionnaire de bénéficier de contrats nécessaires au maintien de l’activité.
Conclusion
La continuation des contrats en cours peut être un levier décisif pour assurer la survie de l’entreprise ou sécuriser la position de ses partenaires (clients, fournisseurs, distribteurs etc.). Chaque situation doit être examinée avec attention, car une mauvaise décision — poursuite ou résiliation — peut entraîner des conséquences financières et juridiques importantes.
Vous êtes dirigeant, fournisseur, prestataire, distributeur ou client d’une entreprise en procédure collective ?
La poursuite ou la résiliation d’un contrat peut avoir des conséquences majeures pour votre activité.
FAQ
Qu’est-ce qu’un contrat en cours en procédure collective ?
Un contrat en cours est un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective et dont l’exécution n’est pas entièrement achevée au jour du jugement d’ouverture. Il peut s’agir par exemple d’un contrat de fourniture, d’un bail commercial, d’un contrat de prestations de services ou encore d’un contrat informatique.
Un cocontractant peut-il refuser la continuation du contrat en cours ?
En principe, le cocontractant ne peut pas refuser la continuation du contrat au seul motif de l’ouverture de la procédure collective ou du non-paiement d’une prestation antérieure au jugement d’ouverture. Toute clause prévoyant la résiliation automatique du contrat en cas de procédure collective est réputée non écrite. Toutefois, la poursuite du contrat est subordonnée au paiement des prestations postérieures. Le cocontractant peut également mettre fin au contrat en respectant les clauses de résiliation prévues au contrat.
Qui paie les prestations après l’ouverture de la procédure collective ?
Les prestations fournies après le jugement d’ouverture doivent être payées à leur échéance. À défaut de paiement, le cocontractant peut demander la résiliation du contrat. Ces créances postérieures bénéficient d’un régime de paiement privilégié et sont en principe payées à l’échéance.
Une question ?
Vous pouvez prendre un premier rendez-vous sans engagement ou me contacter via mon formulaire de contact.
Maître Luc Arminjon – Avocat en droit des entreprises en difficulté : redressement judiciaire, sauvegarde, liquidation judiciaire, mandat ad hoc et conciliation, défense des dirigeants et reprise d’entreprises en difficulté.
Photo illustration : Leiada Krözjhen – Unsplash
Lexique
« Entreprise en difficulté » ou « débiteur » désignent indifféremment la personne morale ou la personne physique qui fait l’objet d’une procédure collective.
Ces termes peuvent le cas échéant désigner l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de prévention des difficultés des entreprises : Mandat ad hoc ou Conciliation.
« Procédure collective » désigne soit une procédure de sauvegarde, soit une procédure de redressement judiciaire, soit une procédure de liquidation judiciaire. Quand cela sera nécessaire, la procédure collective en question sera précisée.
« Jugement d’ouverture » : jugement du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques ou du tribunal judiciaire (selon l’activité et la situation géographique du débiteur) qui prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation d’une entreprise (personne morale ou personne physique).